Rue Bernard
Maintenant que j’allais à l’école et que je pouvais traverser les rues, de tout nouveaux terrains de jeux s’ouvraient à moi. D’autant plus que mes parents ne se gênaient pas pour m’envoyer faire des commissions un peu partout sur le territoire, principalement rue Bernard où j’avais maintenant accès côté nord et sud, de Saint-Laurent à l’avenue du Parc. Les deux premiers commerces où j’ai été autorisé à me rendre furent Chez Maurice et la Poultry. Le premier était situé sur le coin nord-ouest d’Esplanade et Bernard. Étant donné la vocation Kasher de Goldberg, c’est là que j’allais acheter le porc et le baloney. La viande y avait une excellente réputation de fraîcheur et le boucher, Maurice lui-même, était un homme éminemment sympathique. Le deuxième tenait boutique sur le coin sud-ouest de Bernard et Waverly et n’offrait que du poulet. Mais quel poulet! Comme c’était également un abattoir il n’était pas rare, quand la demande était forte, qu’on finisse de plumer votre volaille devant vous, juste avant de l’envelopper grossièrement dans du papier journal. Aujourd’hui, ce magasin ne rencontrerait aucune des normes de salubrité gouvernementale et pourtant, je ne me souviens pas avoir mangé meilleur poulet.
Tout juste à côté, un immense supermarché du vêtement étalait ses deux vitrines de linge bon marché. Bien que mon frère Claude et moi étions invariablement habillés chez Sauvé Frères à chaque retour à l’école, il arrivait qu’en insistant un peu maman nous achète certains articles plus mode en cours d’année. Ce fut le cas pour ma première paire de pantalon ‘’ matelot’’. Jusque là, tous les pantalons étaient taillés étroits au bas de la jambe. En fait, il n’existait pratiquement qu’un seul style. Mais le mouvement hippie aidant, on vit apparaître toutes sortes de nouvelles coupes dont le fameux ‘’matelot‘’, qui reproduisait l’ampleur des vêtements portés par les marins. Tellement ample en fait, qu’entre nous on mesurait la circonférence du bas de nos pantalons, afin de déterminer celui qui était le plus évasé; cela conférait à son détenteur une espèce de supériorité. Je me souviens qu’en sortant de la boutique, je ne pouvais détacher mes yeux du bas de mes nouvelles culottes; je dois bien avoir passé 2 jours à me promener ainsi regardant à peine devant moi, les yeux rivés sur ma nouvelle source de fierté. Jusqu’à ce que Ravanelle, avec ses trente-six pouces de circonférence, ne vienne tous nous rabattre le caquet… Même si ces largeurs démesurées n’ont plus cours de nos jours, il n’en demeure pas moins que ce fut le point tournant qui révolutionna l’allure du pantalon à jamais, la norme étant aujourd’hui le bas large pour beaucoup de coupes.
Toujours rue Bernard, directement en face de chez Donat, un des premiers bar-expresso style italien avait pignon sur rue. Dans notre imagination enflammée, nous y voyions le quartier général de la mafia montréalaise, rempli de personnages louches brassant de grosses affaires non moins louches. La seule chose qui ne m’ait jamais attiré à l’intérieur, c’est la machine à boule. C’était le seul endroit de toute la rue, avec le restaurant de hot-dog Red Hot au coin de Saint-Laurent, à en posséder une. Avec une certaine complaisance on me laissait y jouer, l’endroit étant de toute évidence peu recommandable pour les enfants. C’est donc là que je développai un goût certain pour les jeux de hasard et d’habilité qui ne s’est jamais démenti par la suite.
Sur le même côté de rue, de l’autre côté de la ruelle, s’élevait une institution dédiée aux plaisirs du palais et à la gourmandise, la biscuiterie. En plus des inévitables biscuits, on y trouvait un assortiment gargantuesque de toutes les friandises dont peuvent rêver les enfants. Pas seulement les enfants d’ailleurs puisque mon oncle Paul-Émile m’y envoyait à l’occasion pour lui acheter des Buds (pas la bière, plutôt les rosettes au chocolat ou autres macarons). J’en profitais pour laisser mes sens de la vue, de l’odorat et du goût se gaver des sensations grisantes de l’endroit. Le choix de bonbons, pourtant très respectable, de chez Donat paraissait bien mince en comparaison. Mais comme la biscuiterie vendait les siens à la livre et étant donné nos moyens plutôt limités, nous n’avions pour ainsi dire pas le choix. Ce qui ne m’empêchait nullement de rêver devant ces étalages qui, à mes yeux, semblaient porter la promesse de douceurs infinies.
Un peu plus loin, de biais avec Napoli-Métro, une autre épicerie de moindre importance tentait de survivre au gigantisme relatif de celle d’en face. La première et dernière fois où j’y ai mis les pieds, c’était pour tenter d’y voler quelques paquets de cigarettes. Nous avions remarqué deux faits importants qui, pensions-nous, nous avantageraient dans la perpétration de notre larcin : d’abord la proximité de l’étalage des cigarettes situé derrière la caissière et de la porte de sortie; ensuite le peu d’achalandage du commerce lui-même, ce qui laissait quelquefois les caisses sans surveillance. C’est ainsi qu’au moment jugé propice par un complice affecté à la surveillance, je m’élançai et saisi de deux paquets de cigarettes pour me précipiter vers l’extérieur. Mais là, soit que mon acolyte ait mal fait son travail ou soit par pure malchance, un des employés nous a aperçus ! Il s’en suivit une course éperdue sur la rue Esplanade au cours de laquelle, pour faire diversion, je laissai tomber les cigarettes. Dieu merci, notre poursuivant récupéra le fruit de notre méfait et nous laissa nous enfuir. Etant devenu ‘’persona non grata‘’, je ne remis jamais plus les pieds à cet endroit.
De l’autre côté de la rue se dressait la banque. Édifice majestueux et solennel je m’y sentais toujours très petit, écrasé par la hauteur de ces plafonds vertigineux et l’immensité de cette grande pièce unique entourée de caissières plus affairées les unes que les autres. Comme il n’y avait pas encore de file d’attente unique, il fallait choisir soigneusement la sienne et ce n’était pas nécessairement celle où il y avait le moins de monde qui était la plus rapide. L’efficacité des employées, de même que les besoins et les caractéristiques propres à chaque client, pouvaient aussi faire une grande différence. Un peu de la même façon qu’on évalue aujourd’hui notre choix de file d’attente dans un supermarché. J’étais (et suis resté!) relativement habile à ce petit jeu. Il le fallait parce maman m’envoyait faire ses dépôts à l’heure du midi et je n’avais qu’une petite heure pour dîner avant de retourner à l’école. C’est d’ailleurs en collaboration avec celle-ci que tous les élèves ont été gratifiés, dès leur première année, d’un compte en banque tout neuf. Ce sont bien sûr les parents qui nous donnaient l’argent pour y faire les dépôts, en général de 10 à 50 cents, et ce sont aussi eux, en tout cas en ce qui me concerne, qui en disposaient. Le premier achat fait grâce à ce petit pécule fut deux ceintures de sauvetage destinées à mon frère Claude et moi. C’était devenu une nécessité depuis que nous allions en vacances à La Minerve, dans les Laurentides, et que nous passions une partie de notre temps libre en chaloupe sur le lac à pêcher la barbotte et la perchaude avec papa.
C’est d’ailleurs lui qui m’envoyait faire une de ses rares commissions un peu plus loin sur la rue Bernard au coin de Jeanne-Mance, chez Cousineau, d’où je lui ramenais des tubes et du tabac Embassy. Je crois qu’il fumait cette marque, aujourd’hui disparue, à cause des coupons-cadeaux qu’on y trouvait, coupons que l’on accumulait afin de les échanger contre différents cadeaux choisis dans un catalogue, sur le même principe que les timbres Gold Star. Cette pratique commerciale de l’industrie du tabac était assez répandue à l’époque. Outre la marque précédemment mentionnée, Mark Ten a offert pendant longtemps des coupons détachables à même le paquet, sur la languette supérieure de celui-ci. De son côté, Sweet Caporal avait lancé une variante du jeu de poker où l’on devait former différentes combinaisons avec les cartes trouvées dans les paquets, combinaisons gagnantes échangeables contre des prix en argent. Je n’ai jamais rencontré qui que ce soit qui ait jamais gagné quoi que ce soit à ce jeu…
Mais la frénésie qui y était associée était éminemment palpable. Si bien que de plus en plus conscient des dangers liés à la cigarette ainsi que de ces tactiques commerciales qui en encourageaient fortement la consommation, le gouvernement décida d’intervenir. La publicité de ces produits fut définitivement bannie des ondes de la télévision et on interdit toute forme de coupon ou jeu promotionnel qui y étaient associés. Seul Mark Ten y échappa et pu continuer à offrir ses coupons pendant un autre dix ans grâce à une obscure entente spéciale dont la nature ne fut jamais vraiment divulguée. Il va sans dire qu’à la suite de la promulgation de cette loi, les ventes de ces marques périclitèrent jusqu’à l’extinction sauf pour Mark Ten qui survit encore grâce à une poignée d’irréductibles, le même genre de gens, je suppose, que ceux qui fument encore des cigarettes à bout uni, c’est à dire sans filtre. De toutes façons, si la tendance se maintient, ce seront tous les fumeurs qui seront bientôt considérés comme d’irréductibles indésirables en voie de disparition, comme tous ces autres petits commerces qui jalonnaient la rue Bernard.
Les courses ne me menaient que rarement plus loin que Jeanne-Mance à quelques exceptions près : en plus de Steinberg et de Pascal déjà mentionnés, la pâtisserie, le chinois et Ben’s Delicatessen – alors situé avenue du Parc – étaient synonymes de luxes occasionnels. Le dimanche après la messe, il arrivait que l’on pousse une pointe presque jusqu’à l’avenue du Parc, au Petit Paris – la seule pâtisserie du quartier digne de ce nom – pour invariablement y acheter des mille-feuilles à la crème et des éclairs au chocolat. Quand cela arrivait on était vraiment fou comme des balais! C’était aussi la fête quand, pour une raison ou pour une autre, maman prenait congé de souper et qu’on allait chercher (la livraison à domicile en était à ses premiers balbutiements, je vous le rappelle) des mets chinois ou du Smoked Meat.
Deux autres raisons m’ont amené encore plus loin vers l’ouest en cet âge tendre: la coupe de cheveux et le théâtre Rialto. Dans le premier cas, le barbier de chez Donat ayant définitivement fermé ses portes, il fallait bien en trouver un autre. Il s’avéra que le plus proche se trouvait toujours sur Bernard mais de l’autre côté de l’avenue du Parc; aussi bien dire au bout du monde. Heureusement, soit que la mode évoluait ou encore qu’il était plus doué que l’autre, mais toujours est-il que ce fut la fin de l’époque ‘’ rase-bol ‘’, nos nouvelles coiffures nous laissant enfin quelques cheveux sur la tête. Pour ce qui est du Rialto, qui avait encore une vocation exclusivement cinématographique, j’y vis mes premiers films dont, entre autres, ce que je crois être une des toutes premières versions de Batman. Un vieux film en noir et blanc avec décors et costumes ultra ‘’cheaps‘’ où nos héros ne se déplaçaient pas encore en ‘’Batmobile‘’ mais dans un vieux Dodge des années cinquante. À la sortie, la déception était clairement visible sur le visage de tous les spectateurs, petits et grands, tellement ce navet dénaturait le caractère ‘’Super‘’ de nos ‘’Super-héros‘’. Le Rialto présentait presque exclusivement des films anglophones, ce qui y limitait grandement nos visites. Nous préférions de loin la salle paroissiale Saint-Stanislas – devenu plus tard le cinéma Laurier, situé sur la rue du même nom – que nous avons commencé à fréquenter un peu plus tard.
Finalement, du côté est de la grande rue, où nous ne nous aventurions que très rarement au début, il y avait, sur le coin sud-ouest de Saint-Urbain, un immense magasin de luminaires, Aver Électrique, dans lequel je n’ai mis les pieds qu’une fois pour en ressortir aussitôt, tout ébloui par tant de lustres brillants et de lumières crues. Sur le coin opposé, une buanderie où j’allais faire sécher du linge les jours de grand déluge, accommodait les familles qui n’avaient pas de sécheuses électriques c’est-à-dire à peu près tout le monde. Un peu plus vers Waverly, directement en face de l’église, le troisième dépanneur de cette tranche de rue essayait péniblement de survivre. Il changea plusieurs fois de propriétaire jusqu’à ce qu’un certain Joubert arrive dans le quartier, en fasse l’acquisition, et lui redonne un peu de lustre. C’est d’ailleurs avec le fils Joubert que j’ai appris à jouer sérieusement aux échecs. Il était du genre compétitif, ce qui n’était pas pour me déplaire bien au contraire. Il osa même un jour me défier en affirmant qu’il obtiendrait de meilleures notes que moi à l‘école ! Malgré des efforts plus qu’honnête, il n’a jamais pu faire mieux, lui non plus, qu’une deuxième place.
© SHP et Pierre Prévost, 2019.


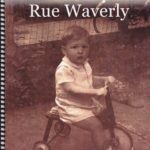

Que de beaux souvenirs !
Très intéressant ! Que de souvenirs ! Merci !
M. Prévost, laissez-moi vous dire que je suis née sur la rue Esplanade (’47), que j’ai fréquenté l’école des filles (en 1953) dont les Sœurs Sainte-Anne en étaient les institutrices . Mon grand-père était sacristain de l’église Saint-Georges (et/ou bedeau). J’ai sonné les cloches avec lui; il demeurait en face de l’Église et m’envoyait au dépanneur voisin lui acheter des petites pilules « Carter». J’ai aussi souvenir d’une épicerie sur le coin nord-ouest qui semble être « Chez Maurice ».
Vous rappelez-vous du nom de famille? Est-ce que le nom de Dagenais vous vient à l’esprit?
Mes grands-parents ont également habiter sur Waverley (avant l’appartement de la rue Bernard). Vous étiez bien mignon sur cette photo, mais j’étais déjà une «grande fille». Les logements de cette époque étaient très grands, et avec de magnifiques boiseries. Je crois que c’est la proximité de mes grands-parents qui a fait de moi une personne très ouverte sur le multiculturalisme. Car c’était un quartier ouvrier, attirant Grecs, Italiens, Juifs, et j’en passe.
Mes parent ont quitté ce charmant et attachant petit coin pour s’établir sur la rive sud, avec un projet d’y construire une 1 ère Crèmerie (genre Dairy Queen) avec le magnifique nom de «Louise Milk Bar».
C’est bien plus tard que j’ai visionné un documentaire (conservé à l’ONF, je crois) relativement au projet de démolition de l’église. C’était 1972, je crois! Et bien tristes étaient ces paroissiens qui se sentaient dépourvus de pouvoir devant cette décision. Tout cet argent offert pour l’édification d’un tel monument, fier représentant d’un patrimoine religieux, qui allait disparaître sous le pic des démolisseurs. Trop cher d’entretien, et la pratique en décadence! J’ai l’impression que cette démolition a fait place à l’école Lambert-Closse. Il y avait trop d’églises et pas assez d’écoles.
Je crois qu’il est temps de fermer cet épisode. Ce fut très intéressant de vous lire. Merci de m’avoir offert cette occasion de faire ma petite narration sur la rue Bernard. J’aimerais en connaitre davantage sur le livre dont il est fait mention dans votre texte. AU plaisir de vous relire et peut-être de faire connaissance devant un bon café. Je suis membre de la SHP, et de la SHRPP.
Bonjour Mme Mantha,
J’ai lu et beaucoup, beaucoup apprécié vos commentaires ! Le but de ces publications étant de raviver de bons souvenirs, de recréer un certain bonheur d’époque, vous me voyez ravi d’y avoir réussi, du moins en ce qui vous concerne.
Le livre dont ce chapitre a été tiré est bel et bien écrit mais pas encore publié. Il comporte presque vingt chapitres, consacrés à la vie du Mile-End dans les années soixante. J’espère une publication du dit bouquin et son lancement à l’automne, si les Dieux du Virus le permettent.
Le chapitre concernant le Patro le Prévost devrait être en ligne avant le lancement.
En attendant, il me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer, dès que les conditions s’y prêterons.
Au plaisir !!!!
Est-ce que le nom de votre Grand père était Georges Mantha?
Moi mon grand père Louis Rocheleau a été concierge à l’académie Saint-Georges à partir de 1914 à peu près. Ma mère Bernadette est venue au monde en 1922 dans le logement du concierge de l’école et si tout ça concorde l’épouse de votre grand père serait la soeur de mon grand-père
J’ai eu le bonheur de lire le premier jet de ce récit aux abords du lac Philip en 2003, enceinte jusqu’aux oreilles de notre premier fils Cédric et partageant le confort d’un hamac familial avec Pierre. Que ça rappelle de bons souvenirs!
Très bien décrit ce quartier que j’ai connu un peu plus tard, entre les années 68 à 75, en allant au Patro « Le Prévost » sur la rue Saint-Dominique à l’est de Saint-Laurent. Les commerces avaient déjà changés un peu à cette époque.
Merci Pierre et salutations à la famille de ma part.
Intéressant cousin! Beau récit! Bien hâte de te relire à nouveau!
J’ai beaucoup de difficultés à me situer géographiquement ….Un petit plan me ramènerait moi qui ai fréquenté l’ESSS près du parc Laurier durant les années 1956 à 1958.
Au plaisir et félicitations pour ce beau récit.
André Burns finissant de 1958 à l’ÉSSS
Très bonne idée d’inclure un plan. Il y en a un dans l’édition complète du livre. Je vais le publier dans le blogue au prochain épisode.
Quels beaux souvenirs ! Hâte de lire la suite !
Récit super intéressant. On vit le quotidien du quartier et on visite de nombreux commerces qui ont, très certainement, laissé de nombreux souvenirs à toute une génération. Vivement la suite (dans quelques temps quand même, afin de laisser les gens sur leur appétit).
Ce genre de récit est ce que notre société d’histoire souhaite lire sur son site. Allez ! à vos plumes les gens du Plateau.
Merci beaucoup ! La suite pour noël !!!!!